
Andrew Niccol fait partie de ces nombreux réalisateurs australiens et néo-zélandais qui ont quitté leur pays d’origine (cf. dossier ci-joint). En effet, il part rapidement pour l’Angleterre où il va tourner plusieurs spots publicitaires. Ensuite, il traverse l’Atlantique pour aller s’installer à Hollywood où il réalise Bienvenue à Gattaca, un film de science-fiction qui ne passe pas inaperçu à sa sortie.
Avec son premier film, Andrew Niccol signe un coup de maître ambitieux, applaudi unanimement par les critiques. Certains voient en Andrew Niccol, réalisateur/ scénariste de ses propres films, un nouvel Orson Welles. Tous acclament donc une œuvre originale, à la fois classique et moderne, mais surtout peu conventionnelle. Pourtant, malgré les nombreuses qualités du film et la pertinence de son propos, le spectateur éduqué se doit de remettre ce film à sa véritable place.
Tout d’abord, Bienvenue à Gattaca est un film de science-fiction dans le sens où il émet des hypothèses sur notre monde à venir en prenant en compte de probables avancées scientifiques.
C’est aussi un film d’anticipation dans la grande tradition des romans tels que Le Meilleur des Mondes (1932) d’Aldous Huxley, 1984 (1948) de George Orwell ou encore Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury ainsi que des films qui en découlent[1]. Il anticipe en effet une société nouvelle ou plutôt différente, mais, par opposition à l’utopie, il prévoit un avenir sombre voire effrayant. Il s’agit d’une dystopie, c’est-à-dire d’un récit de fiction où les auteurs présentent un monde qui a empiré.
Dans Bienvenue à Gattaca, comme dans de nombreuses œuvres du même genre, c’est la science qui est responsable des conséquences désastreuses sur ce monde « not too far » comme on l’indique au spectateur au début du film. Ainsi, la génétique, comme dans Le Meilleur des Mondes d’Huxley, règle les nouvelles valeurs et normes de la société : elle institue une discrimination entre « valides » et « invalides ».
Les « valides » sont des individus aux gènes irréprochables, c’est-à-dire pourvu de gènes qui déterminent de bonnes capacités physiques, une parfaite physiologie et une santé excellente. Ceux-ci ne peuvent être créés que par fécondation « in vitro ». Cette volonté d’améliorer l’espèce humaine se rapporte de façon évidente à l’eugénisme.
En revanche, les « invalides » sont le fruit de procréations humaines. Ceux-là héritent des imperfections liées aux gènes défectibles. De cette différence (par ce qu’il s’agit bien de cela), une discrimination s’est instaurée, principalement dans le monde du travail qui détermine toute la condition sociale de l’homme dans cette société futuriste.

La science est donc ici responsable du malheur des individus de cette société divisée en deux. Cependant, Niccol ne veut pas faire une critique totale de la génétique comme il l’indiquait dans une interview : « Je ne voudrais pas que l'on voie ce film en pensant qu' il affirme que la génétique va nous entraîner en enfer, car il y a eu et il y aura des quantités d'application positives de cette science, particulièrement en matière de médecine. Le problème est avant tout une question d'éthique. Comment situe-t-on la ligne qui sépare l'éradication d'une maladie de l'amélioration de l'être humain ? Jusqu'où peut-on aller ? Doit-on considérer la myopie ou la calvitie précoce comme une maladie ? Où faut-il s'arrêter ? ».
Niccol, qui s’est documenté sur les pratiques discriminatoires appliquées dans certaines grandes sociétés et compagnies d’assurances, s’intéresse donc aux déviances de la médecine et de la science et surtout à leurs conséquences.
En effet, les rapports entre individu et société ont eux aussi été modifiés. L’individu est avant tout soumis aux règles de la collectivité. La population étant étroitement surveillée et encadrée, aucune rébellion n’est possible. Le contrôle des esprits et l’effacement de l’individu face à la collectivité sont des éléments fondamentaux de cette société totalitaire. La police est omniprésente et les inspecteurs ont d’ailleurs quelques airs d’officiers de la Gestapo. Si l’on poursuit la comparaison avec les régimes totalitaires, on peut aussi assimiler l’eugénisme avec la volonté des nazis de créer un monde peuplé entièrement d’aryens.
Dans la société de Bienvenue à Gattaca, on constate un effrayant phénomène de robotisation de l’humain, formaté par la société. Dans la base de Gattaca, un complexe complètement aseptisé, tous les employés sont parfaitement identiques, c’est-à-dire en costume cravate et sans distinction aucune par rapport aux autres.
C’est donc dans ce monde déshumanisé que Vincent, un « invalide » ambitieux, va essayer de transgresser les règles. Le film suit une construction narrative non linéaire et c’est Vincent lui-même qui nous conte son histoire.
Voulant à tout prix devenir astronaute, le jeune binoclard aux problèmes cardiaques va conclure un accord avec Eugène (en référence à l’eugénisme) pour utiliser l’identité de ce « valide » déchu à cause d’un accident de voiture. Pour tromper les autorités de la base de lancement spatiale du nom de Gattaca (G, T, A, et C sont les lettres qui codent les nucléotides, éléments de base de l’ADN), Eugène lui transmet son sang, son urine, ses empreintes digitales, ses cheveux, ses cils, ses ongles (c’est sur ces plans intrigants que s’ouvre le film)…
Renonçant à sa personnalité et à sa différence, Vincent devient ainsi un « valide » de plus. Cependant, malgré toute sa bonne volonté, il commettra une lourde erreur en perdant un cheveu par inadvertance. De plus, la mort mystérieuse d’un employé de la base ne va pas arranger sa situation délicate.
Cependant, même si Niccol flirte un peu avec le thriller, il signe avant tout un film de science-fiction dont le style visuel se rapporte beaucoup à celui des films des années 50, surtout dans l’architecture des bâtiments. Cependant, Bienvenue à Gattaca refuse tous effets spéciaux. En fait, Niccol préfère truffer son film de références cinématographiques et à la science-fiction.
Faisant un clin d’œil à H. G. Wells (le nom du personnage d’Eugène, Morrow, renvoie à L’Ile du Docteur Moreau, dans lequel Welles décrit d’horribles expériences génétiques) ; il fait surtout référence aux autres films d’anticipation : de nombreuses scènes du film ont été tournées dans les décors de THX 1138 (1971) de George Lucas alors que le couloir illuminé et ovale de la fin de Bienvenue à Gattaca renvoie tout de suite à celui de 2001 : L’Odyssée de l’Espace (1968) de Stanley Kubrick. L’escalier ovale de l’appartement d’Eugène fait quant à lui autant penser à la double hélice de l’ADN qu’à l’escalier d’Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965) de Jean-Luc Godard.

 2001: L'Odyssé de l'Espace (1968) de Stanley Kubrick
2001: L'Odyssé de l'Espace (1968) de Stanley KubrickCependant, malgré les nombreuses qualités de Bienvenue à Gattaca, Niccol ne parvient pas à égaler ses modèles. En fait, à la fin du film, Vincent, éternel rebelle, arrive à réaliser son rêve d’enfant en quittant son poste de personnel d’entretien de la base de Gattaca et en devenant enfin un véritable astronaute.
Alors, certes, Niccol dénonce l’absence de déterminisme dans le code génétique et prône le courage d’un homme prêt à tout pour se débarrasser de ses handicaps. Cependant, il réside quand même un point faible dans le message du film. En effet, il tente de concilier un message réactionnaire (dénoncer une médecine dangereuse et une société possiblement inhumaine) avec un message profondément américain et conventionnel : le « You can get it if you really want it », le rêve américain, celui de la réussite.
De plus, Niccol a ajouté une histoire gnangnan de concurrence entre Vincent et son frère : ceux-ci rivalisent lors de courses à la nage, du genre « le premier qui arrive au rivage est le plus fort ». Bien sûr, Vincent, après de nombreux essais, finira par gagner et sauvera même la vie de son cadet. Selon Niccol, l’individu peut se surpasser s’il s’en donne les moyens. C’est une belle morale mais, dans le film, elle apparait un peu niaise et surtout typiquement hollywoodienne.

Car Bienvenue à Gattaca est bien un film hollywoodien. C’est un gros budget avec trois jeunes acteurs très en vogue : Ethan Hawke et Uma Thurman (qui se marient à la fin du tournage) ainsi que Jude Law. De plus, Niccol a fait appel pour les seconds rôles à des « vieux lions » : Alan Arkin, Ernest Borgnine ainsi que le dramaturge et scénariste Gore Vidal.
La musique est signée par l’Anglais Michael Nyman. Cette partition de violon, larmoyante à souhait, est, il faut bien le reconnaitre, tout de même émouvante. Pour la photographie, Niccol s’est entouré du Polonais Slavomir Idziak qui utilise parfois le sépia. Avec ce chromage volontaire, le film baigne dans un parfum de passé, ce qui est tout de même assez original pour un film futuriste…
Malgré de nombreuses qualités, Bienvenue à Gattaca n’est donc pas le chef d’œuvre que tout le monde a acclamé. En fait, l’originalité du sujet abordé souffre de sa morale conventionnelle qui gâche le propos de ce film à thèse. C’est pour cette raison que Niccol ne parvient pas à égaler des films comme THX 1138 (1971) de George Lucas ou Soleil vert (1973) de Richard Fleisher.
Après le succès de Bienvenue à Gattaca, Niccol signe S1m0ne (2002), une réflexion sur le statut de « star ». Ensuite, il réalise Lord of War (2005) sur le trafic d’armes. Comme Bienvenue à Gattaca, le film bascule dans le drame, atténuant alors aussi la force de son propos. Entre temps, Andrew Niccol écrit les scénarii de The Truman Show (1998) de Peter Weir et du Terminal (2001) de Steven Spielberg. Actuellement, il est en train de tourner un film sur Dali avec Al Pacino (qui jouait déjà dans S1m0ne) dans le rôle titre.
13.04.08.

[1] 1984, version de 1956 par Michael Anderson et version de 1984 par Michael Radford et Fahrenheit 451 (1966) de François Truffaut.


 Le film de Sternberg a beaucoup influencé Howard Hawks qui avait participé au scénario sans être crédité, l’oscar du meilleur scénario revenant à Ben Hecht, le véritable auteur du script. Lorsqu’ils écriront tous deux le scénario de Scarface que Hawks réalisera en 1932, ils réutiliseront de nombreux éléments des Nuits de Chicago : des gangsters qui feignent d’être fleuristes, une fête grandiose avec pacotilles, un final avec le gangster retranché dans une maison assaillie par les flics et tirant sur ceux-ci avec une mitraillette Thompson. De plus, le néon « The City is Yours » est changé en « The World is Yours » et le « side-kick » des Nuits de Chicago jouant avec son chapeau est remplacé par le personnage interprété par George Raft dans Scarface qui joue avec une pièce.
Le film de Sternberg a beaucoup influencé Howard Hawks qui avait participé au scénario sans être crédité, l’oscar du meilleur scénario revenant à Ben Hecht, le véritable auteur du script. Lorsqu’ils écriront tous deux le scénario de Scarface que Hawks réalisera en 1932, ils réutiliseront de nombreux éléments des Nuits de Chicago : des gangsters qui feignent d’être fleuristes, une fête grandiose avec pacotilles, un final avec le gangster retranché dans une maison assaillie par les flics et tirant sur ceux-ci avec une mitraillette Thompson. De plus, le néon « The City is Yours » est changé en « The World is Yours » et le « side-kick » des Nuits de Chicago jouant avec son chapeau est remplacé par le personnage interprété par George Raft dans Scarface qui joue avec une pièce.
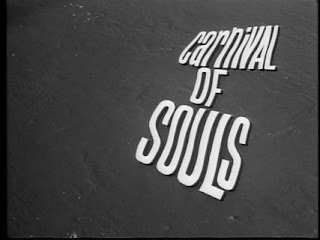











 Metropolis est avant tout un film au tournage pharaonique de plus d’un an. Il a nécessité 36 000 figurants, 620 km de pellicule et le budget est passé de un à six millions de marks… Pour l’occasion, la UFA construit de gigantesques décors et engage les meilleurs techniciens : la photographie est confiée au talentueux Karl Freund
Metropolis est avant tout un film au tournage pharaonique de plus d’un an. Il a nécessité 36 000 figurants, 620 km de pellicule et le budget est passé de un à six millions de marks… Pour l’occasion, la UFA construit de gigantesques décors et engage les meilleurs techniciens : la photographie est confiée au talentueux Karl Freund
 De plus, Lang expérimente beaucoup de techniques cinématographiques comme la surimpression, la caméra placée sur une balançoire ou encore le montage parallèle. Des recherches originales sont aussi effectuées au niveau des cartons. Le projet de Lang est donc très ambitieux du point de vue artistique.
De plus, Lang expérimente beaucoup de techniques cinématographiques comme la surimpression, la caméra placée sur une balançoire ou encore le montage parallèle. Des recherches originales sont aussi effectuées au niveau des cartons. Le projet de Lang est donc très ambitieux du point de vue artistique. Ensuite, Metropolis rappelle l’héritage chrétien de la civilisation européenne : la réunion des ouvriers dans des souterrains comme les chrétiens dans les catacombes, la très sainte Maria qui prie pour la paix et attend la venue d’un médiateur (le messie) et qui s’oppose à l’Eve tentatrice, son double en robot, qui finira par être brulée sur le parvis d’une cathédrale comme une sorcière, ou encore le cauchemar de Freder qui aperçoit la Mort avec sa faux, accompagnée des sept péchés capitaux.
Ensuite, Metropolis rappelle l’héritage chrétien de la civilisation européenne : la réunion des ouvriers dans des souterrains comme les chrétiens dans les catacombes, la très sainte Maria qui prie pour la paix et attend la venue d’un médiateur (le messie) et qui s’oppose à l’Eve tentatrice, son double en robot, qui finira par être brulée sur le parvis d’une cathédrale comme une sorcière, ou encore le cauchemar de Freder qui aperçoit la Mort avec sa faux, accompagnée des sept péchés capitaux.








